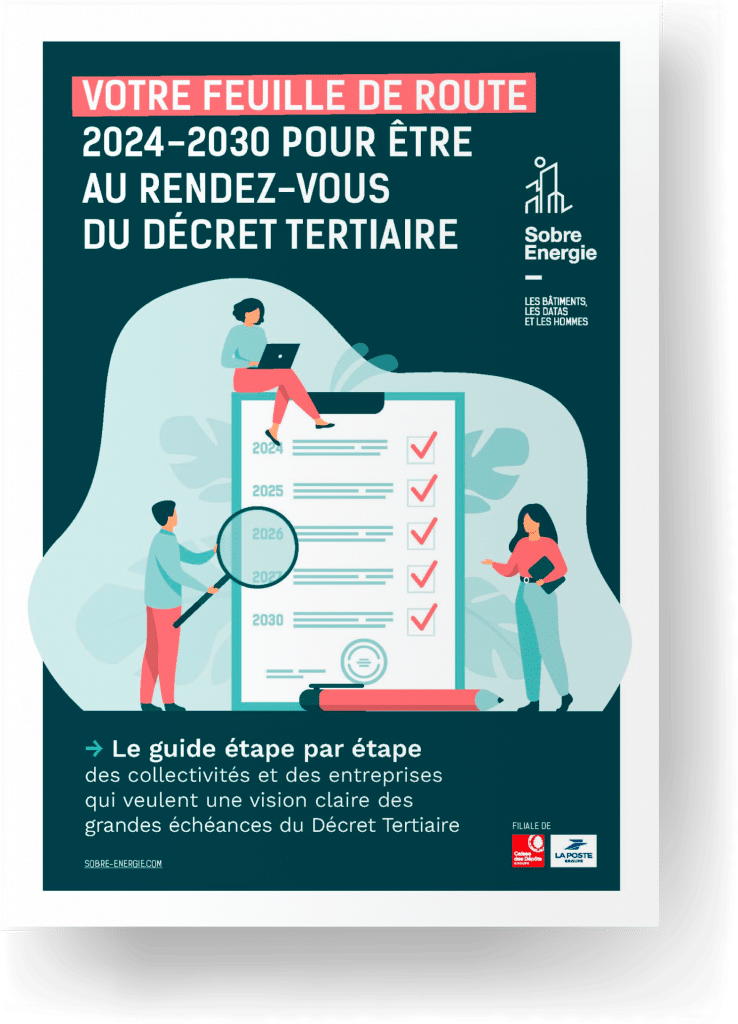L'autoconsommation photovoltaïque connaît un essor remarquable en France depuis deux ans, notamment dans le secteur des bâtiments tertiaires. Cette dynamique s'explique par une combinaison de facteurs environnementaux, réglementaires et économiques.
Pourquoi privilégier l’autoconsommation ?
Un impératif de décarbonation des bâtiments tertiaires
La France s'est engagée dans une stratégie ambitieuse de décarbonation, en ligne avec les recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Les bâtiments tertiaires, qui regroupent les immeubles de bureaux, commerces, établissements d’enseignements, administratifs sont au cœur de cette stratégie. Ces bâtiments représentent une part significative des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France.
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), lancée par l’Etat en 2015, impose des objectifs clairs de réduction des émissions de GES d'ici 2050. Elle prévoit pour le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire réuni) de diminuer de 95% les émissions de GES à cet horizon.
Pour y parvenir, il est essentiel de réduire la consommation d'énergie fossile et d'encourager l'utilisation des énergies renouvelables. Notamment pour le chauffage des bâtiments en remplaçant les chaudières au fioul ou au gaz par des pompes à chaleur.
L'autoconsommation photovoltaïque, en permettant de produire et consommer sur place une électricité décarbonée, devient ainsi une réponse pertinente à cet impératif de décarbonation. Cette démarche permet non seulement de limiter les émissions de CO2 mais aussi de contribuer à la souveraineté énergétique de la France.
Un contexte réglementaire qui se renforce
Le cadre réglementaire français s'est considérablement renforcé ces dernières années pour encourager la transition énergétique dans le secteur tertiaire. Plusieurs textes de loi et décrets visent à accélérer l'intégration des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments.
- Le Décret Tertiaire : issu de la loi Elan de 2018, impose aux bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² de réduire leur consommation énergétique de 40 % d'ici 2030, de 50 % d'ici 2040, et de 60 % d'ici 2050, par rapport à une année de référence. L'installation de panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation s'inscrit pleinement dans cette logique, en réduisant la dépendance aux énergies conventionnelles et en contribuant à l'atteinte de ces objectifs. Les consommations des bâtiments d’énergie d’origine renouvelable (solaire, géothermie par exemple) peuvent ainsi être décomptées du total des consommations, après avoir été sous-comptées.
- Le Décret BACS (Building Automation & Control Systems) complète cette dynamique en obligeant les bâtiments tertiaires à s'équiper de systèmes d'automatisation et de contrôle d'ici le 1er janvier 2025. Ces systèmes permettent d'optimiser la gestion énergétique et favorisent l'intégration des énergies renouvelables, rendant ainsi l'autoconsommation photovoltaïque encore plus pertinente.
- La loi APER (Accélération Pour les Energies Renouvelables), adoptée en 2023, vise à faciliter et accélérer le déploiement des énergies renouvelables en France. Cette loi simplifie les procédures administratives pour l'installation de panneaux photovoltaïques, notamment sur les bâtiments tertiaires, ce qui contribue à l'accélération de l'autoconsommation. Ainsi elle rend obligatoire l’installation de panneaux solaires en toiture d’ici 2028 pour les bâtiments tertiaires de plus de 500m². Mais aussi l’installation d’ombrières photovoltaïques pour les parkings de plus de 1500m² d’ici 2026/2028.
Une solution économique face à la hausse des prix de l'électricité
Depuis 2022, le marché de l'électricité en France a été marqué par une hausse significative des prix, en partie due à la crise énergétique mondiale. Cette situation a incité de nombreux acteurs du tertiaire à chercher des alternatives pour réduire leur facture énergétique. L'autoconsommation photovoltaïque s'impose alors comme une solution économique viable.
Produire sa propre électricité permet de s'affranchir, en partie, des fluctuations des prix du marché. De plus, la réforme à venir de l'ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) pourrait entraîner une diminution des quotas d'électricité à prix régulé pour les entreprises, augmentant ainsi leur exposition aux prix du marché. L'autoconsommation devient dès lors une stratégie de sécurisation des coûts énergétiques à long terme.
Un phénomène en développement croissant
Les énergies renouvelables (éolien et solaire) sont en pleine expansion au niveau européen en général, comme en France.
La part de l’électricité produite par l’éolien et le solaire dans l’Union européenne a atteint pour la 1e fois 30%, au cours du premier semestre 2024, selon les chiffres du centre d’étude britannique Ember*. Un chiffre en progression de 13 % par rapport au premier semestre 2023, dépassant la production d’électricité à partir de combustibles fossiles, évaluée à 27 %.
Une tendance similaire en France, selon le dernier bilan du système électrique publié en juillet par RTE : au premier semestre 2024, la production solaire a ainsi atteint 11,4 TWh égalant pour la première fois la production thermique fossile.
Autoconsommation collective
Aujourd’hui, en France, l’autoconsommation collective est en croissance constante :
• 6 opérations recensées en 2018
• 428 projets actifs en mai 2024
• 625 encore à l’étude
Résultat, ce sont 4 776 consommateurs** qui sont embarqués dans une opération collective, pour une puissance totale de production de 33 619 kilovoltampères (kVA). Principalement des collectivités locales, qui souhaitaient valoriser leurs toitures dans un contexte de forte volatilité des prix de l’énergie. Mais aussi de plus en plus de bailleurs sociaux, des entreprises ou encore des zones d'activité économique.
Autoconsommation individuelle
A l’échelle individuelle aussi, le boom du solaire se confirme : au deuxième trimestre 2024, l'autoconsommation individuelle a franchi la barre des 500 000 installations (556 039 exactement), soit une croissance de 71 % en un an, selon les chiffres publiés par le gestionnaire du réseau de distribution Enedis.
Autoconsommation et flexibilité électrique
Dans un contexte de décarbonation des bâtiments, mais aussi des transports (secteur le plus émetteur de GES en France avec 34% des émissions l’an dernier), l’électrification de nos usages est un enjeu crucial.
Notre mix énergétique national demain sera plus électrique et moins carboné. Mieux consommer, mais aussi moins consommer dans l’esprit du Décret Tertiaire.
Et les bâtiments tertiaires ont un rôle clé à jouer pour contribuer à flexibiliser la demande électrique sur le réseau.
La GTB pour piloter production et autoconsommation
L'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments GTB (Gestion Technique des Bâtiments) vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires avec :
• L’intégration de dispositifs permettant la régulation automatique du chauffage, de la ventilation, de la climatisation (CVC), et de l’éclairage.
• La mise en place de systèmes de gestion permettant de suivre les consommations énergétiques en temps réel, ce qui facilite l'identification des gisements d'économies d'énergie.
L'objectif est de permettre une gestion plus efficace de l’énergie, en alignant l’utilisation des équipements au maximum sur les phases de production solaire du bâtiment. Et ainsi en réduisant le gaspillage et les consommations inutiles, ce qui est essentiel pour respecter les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées par la loi.

Le stockage par les véhicules électriques
Aligner au maximum production photovoltaïque et consommation de l’électricité produite est particulièrement pertinent au sujet de la mobilité. En rechargeant par exemple les véhicules électriques au moment où la centrale solaire produit le plus. Si le véhicule n’est pas utilisé ensuite, il peut même servir de stockage d’électricité grâce à sa batterie. Electricité qui peut être ensuite réinjectée sur le réseau plus tard, à un moment où la centrale solaire ne produira pas assez pour couvrir la consommation à un instant t. Ce concept, souvent appelé Vehicle-to-Grid (V2G), transforme les véhicules électriques (VE) en éléments actifs du réseau électrique, offrant de multiples avantages.
Au-delà des bâtiments tertiaires, cet enjeu de flexibilité du réseau électrique concerne aussi les particuliers sur le résidentiel. La commission de régulation de l’énergie a lancé une consultation pour réviser les tarifs réglementés de vente de l’électricité***. Objectif : revoir le système tarifaire heures creuses/heures pleines qui incite actuellement à décaler ses consommations électriques la nuit. Pour inciter plutôt les consommateurs à adapter leurs usages aux heures où la production solaire est importante.
L’ajout de bornes de recharge va logiquement augmenter la demande en électricité. Il est crucial pour les gestionnaires de bâtiments d'anticiper cette hausse de consommation, en ajustant la capacité électrique de leur bâtiment, voire en prévoyant des systèmes d’optimisation de charge. Ces systèmes, souvent appelés "smart charging", permettent de réguler les pics de consommation, en distribuant l’énergie de manière plus efficace et en évitant les surcharges du réseau.
En conclusion, le développement de l'autoconsommation photovoltaïque dans les bâtiments tertiaires en France répond à un triple impératif : écologique, réglementaire et économique. Face aux défis de la décarbonation, à un cadre législatif de plus en plus contraignant et à la volatilité des prix de l'énergie, l'autoconsommation apparaît comme une solution durable et stratégique pour le secteur tertiaire.
** Source Actu Environnement Enogrid